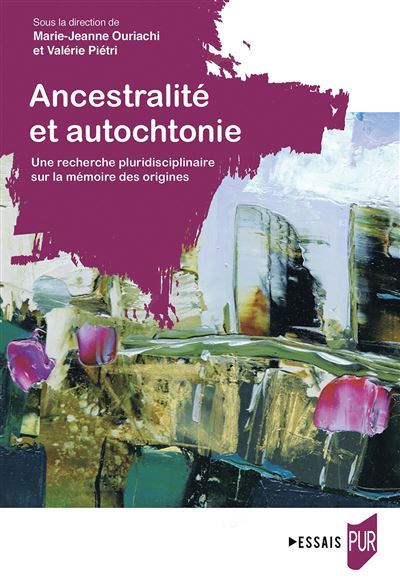Ce projet interdisciplinaire porte sur la question de la mémoire des origines, comme élément de construction des identités et des territoires.
Porteur de projet
- Valérie PIETRI (URMIS)
- Marie-Jeanne OURIACHI (CEPAM)
Partenaires
- Marie Pierre Ballarin (URMIS)
- Lucie Bargel (ERMES)
- Frédérique Bertoncello (CEPAM)
- Giulia Bonacci (URMIS)
- Joël Candau (LAPCOS)
- Karine Emsellem (ESPACE)
- Yvan Gastaut (URMIS)
- Guillaume Gonin (ERMES)
- Giovanni Gugg, Université « Federico II » de Naples (LAPCOS)
- Rania Hanafi, UCA (URMIS)
- Xavier Huetz de Lemps (CMMC)
- Laurence Mercuri (CEPAM)
- Marc Ortolani (ERMES)
Dates
2019 – 2024
Sources de financement
- MSHS Sud-Est , Axe 4 Territoires : construction, usages, pouvoirs
- CEPAM
Objectifs
Résumé :
Ce projet interdisciplinaire porte sur la question de la mémoire des origines, comme élément de construction des identités et des territoires. Le rapport aux origines se construit, en effet, autour de deux formes d’appartenance souvent combinées : l’ancestralité (comme rapport aux origines familiales) et l’autochtonie (comme rapport aux origines géographiques). Dans le cas des familles aristocratiques et/ou coloniales, le patronyme constitue un marqueur fondamental des identités sociales : il intègre bien souvent une dimension spatiale tandis que les terres et domaines sont parfois désignés par le nom de leurs propriétaires. De la même manière, descendants de migrants ou d’esclaves sont identifiés (et stigmatisés) ou revendiquent comme part constitutive de leur identité ce déracinement originel. Ce rapport entre l’identité lignagère et le lieu d’origine pose donc aussi la question de la mobilité, qu’elle soit sociale (ascension/descension sociale), géographique (migration, exil) ou politique (contexte de colonisation/décolonisation/post-coloniale, esclavage et post-esclavage).
Objectifs et méthodologie :
La problématique de la mémoire des origines, qui associe une analyse critique de la notion d’origine et une réflexion sur l’expression spatiale des identités individuelles et collectives, nécessite une approche résolument interdisciplinaire. Pour mener à bien cette recherche, nous avons donc souhaité mettre en place une équipe associant historiens, archéologues, sociologues, géographes et politistes afin de développer un espace de dialogue et d’échange sur les concepts, méthodes et outils que les différentes disciplines impliquées mobilisent pour appréhender cette question de la mémoire des origines.
Actualités, évènements
Deux workshops ont permis de mettre en évidence la richesse de cette thématique dès lors qu’on l’étudie dans la longue durée (de l’antiquité au monde contemporain) et qu’on applique cette grille de lecture à des sociétés et des contextes très divers. Il s’agissait de réfléchir à la manière dont s’élabore et se perpétue cette mémoire des origines - voire dont elle est réinventée -, aux stratégies parfois mises en place par les autorités pour en assurer le contrôle, à son inscription dans l’espace.
Les deux workshops ont montré les spécificités de chaque discipline à la fois du point de vue des sources (artefacts archéologiques, sources écrites connues par la tradition manuscrite ou archives textuelles et iconographiques, sources orales, monuments…) et des méthodes mobilisées (récolement documentaire ou enquête de terrain, approches qualitatives et/ou analyses quantitatives…).
- 6-7 juin 2019 : "Mémoire des origines, lieux et récits de vie : approches croisées en sciences humaines et sociales" (13 communications pour les deux sessions : Mémoire des origines, autochtonie et mobilité spatiale / Pratiques d’écriture, traces graphiques, images et monuments)
- 12-13 décembre 2019 : "Territoires et mémoire des origines" (9 communications)
Publications
- "Ancestralité et autochtonie. Une recherche pluridisciplinaire sur la mémoire des origines", ouvrage collectif sous la direction de Marie-Jeanne Ouriachi et Valérie Piétri, avec le soutien de la MSHS Sud-Est, du CEPAM et de l'URMIS.
Comment la mémoire des origines participe-t-elle à la construction des identités et des territoires ? Cette interrogation, qui traverse les individus et les sociétés dans la longue durée, est abordée dans ce volume en questionnant le rapport aux origines autour de deux formes d’appartenance : l’ancestralité (comme rapport aux origines familiales) et l’autochtonie (comme rapport aux origines géographiques). La problématique de la mémoire des origines, parce qu’elle associe une analyse critique de la notion d’origine et une réflexion sur l’expression spatiale des identités individuelles et collectives, nécessite une approche résolument pluridisciplinaire. L’ouvrage regroupe ainsi les contributions d’historiens spécialistes des différentes périodes, d’archéologues, d’anthropologues, de politistes et de juristes afin de confronter les concepts et les méthodes autour d’un objet partagé. Ce choix a permis de multiplier les contextes d’analyse — avec une attention particulière portée aux enjeux de mémoire liés au fait colonial — et de confronter différentes manières de faire vivre cette mémoire des origines, à travers des mots, des objets, des lieux.
Publié avec le soutien de la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société Sud-Est (UAR 3566, CNRS, Université Côte d’Azur, Université de Corse Pasquale Paoli), du laboratoire CEPAM (UMR 7264-CNRS, Université Côte d’Azur) et du laboratoire URMIS (UMR 8245-CNRS, UMR 205-IRD, Université Côte d’Azur, Université Paris Cité)
Presses Universitaires de Rennes :
https://pur-editions.fr/product/10236/ancestralite-et-autochtonie